Par Hélène Joubert, avec le Pr Grégoire Robert, urologue (CHU de Bordeaux), coordonnateur du groupe de travail des Recommandations AFU / HAS 2024 « Bilan préthérapeutique des troubles mictionnels de l'homme »
En résumé
■ Les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) peuvent relever d’étiologies très variées et ne présument pas forcément d’une origine prostatique.
■ Le calendrier mictionnel n’est plus recommandé qu’en cas de symptômes prédominants de la phase de remplissage.
■ L’échographie avec mesure du résidu post-mictionnel doit être systématique.
■ Aucun examen invasif (cystoscopie, bilan urodynamique, échographie par voie endorectale) n’est préconisé de façon systématique en première intention.
INTRODUCTION
Les troubles mictionnels font partie des troubles les plus fréquemment rapportés chez l’homme adulte.
Alors que la prostate est souvent incriminée, ces troubles peuvent en fait relever d’étiologies très diverses (voir ci-dessous), ce qui complexifie la démarche diagnostique.
Afin d’optimiser et d’harmoniser les pratiques, mais aussi de réduire le nombre d’examens inutiles et/ou invasifs, l’Association française d’urologie (AFU) a publié en 2024 une recommandation de bonne pratique (RCP) sur le bilan préthérapeutique des troubles mictionnels de l'homme. Élaborée de façon pluridisciplinaire, avec les différents professionnels concernés, cette nouvelle RCP (labellisée HAS) vient actualiser les précédentes recommandations de l’AFU qui dataient de 2014.
Elle concerne les hommes de 50 ans et plus présentant des symptômes du bas appareil urinaire ou une complication en lien avec un trouble de vidange du bas appareil urinaire (rétention d’urine, aiguë ou chronique, complication infectieuse, calcul, diverticule). Les symptômes en rapport avec une pathologie neurologique, une sténose de l’urètre ou une tumeur de la vessie déjà connus en sont exclus.
Cet article revient sur le bilan à effectuer, en médecine générale, dans le cadre d’une évaluation initiale puis avant toute mise en route d’un traitement médical. De manière générale, un interrogatoire précis et un examen clinique rigoureux sont essentiels ainsi que certains examens complémentaires adaptés. Leur utilisation dépend du profil de chaque patient, de ses antécédents et de ses symptômes.
Le bilan plus spécialisé préconisé en cas d’échec du traitement médical ou lorsqu’un traitement chirurgical ou interventionnel est envisagé n’est pas traité ici.
DÉFINITIONS
• Une miction normale se caractérise par :
– une miction volontaire, facile, indolore et complète, durant moins d'une minute ;
– de chronologie diurne avec un délai entre les mictions supérieur à 2 heures ;
– de débit maximal (Qmax) > 15 ml/s;
– avec un résidu post-mictionnel < 50 ml (ou à un tiers du volume de la miction).
• Lorsque ces critères ne sont pas vérifiés, on parle de troubles mictionnels ou plus largement de SBAU (symptômes du bas appareil urinaire). En théorie, le terme “trouble mictionnel” concerne la miction alors que le terme SBAU recouvre aussi les symptômes de la phase de remplissage. En pratique, les deux termes sont souvent utilisés de façon indifférenciée. Dans la nomenclature internationale, le terme retenu est LUTS (Lower Urinary tract symptoms) ce qui se traduit par SBAU.
Selon la typologie des symptômes par rapport à la miction, on distingue les symptômes de la phase mictionnelle, de la phase post-mictionnelle et de la phase de remplissage (voir encadré ci-dessous).
Les symptômes du bas appareil urinaire de l’homme
Symptômes de la phase mictionnelle
‒ faiblesse du jet, jet en arrosoir, haché ou hésitant
‒ miction par poussée abdominale
‒ gouttes terminales, miction traînante
Symptômes de la phase post-mictionnelle
‒ sensation de vidange vésicale incomplète (impression subjective)
‒ gouttes retardataires
Symptômes de la phase de remplissage
‒ pollakiurie diurne
‒ pollakiurie nocturne
‒ nycturie : miction nocturne précédée et suivie par une phase de sommeil (pas de notion de fréquence ni de volume)
‒ urgenturie : désir soudain, impérieux et irrépressible d’uriner
‒ incontinence urinaire : fuite involontaire d’urine
ÉTIOLOGIES
Les étiologies des troubles mictionnels chez l'homme sont très variées. Elles peuvent être liées à des pathologies prostatiques, mais aussi à des affections vésicales, urétrales, endocriniennes, neurologiques, infectieuses, ainsi qu’à certaines pathologies du sommeil (apnées du sommeil).
Ces différentes pathologies peuvent entraîner une obstruction à la vidange de la vessie (obstruction sous-vésicale ; OSV)et/ou un dysfonctionnement vésical (hypo et hyperactivité détrusorienne).
> Principales causes de dysfonctionnements vésicaux
L’hypoactivité détrusorienne peut être liée à de nombreuses causes : syndrome de la queue-de-cheval, obstruction sous-vésicale chronique, neuropathie diabétique, sensibilité vésicale réduite, utilisation prolongée de médicaments (antiparkinsoniens L-Dopa et agonistes dopaminergiques, anti-cholinergiques, antispasmodiques, anti-dépresseurs tricycliques, inhibiteurs calciques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, opioïdes, benzodiazépines et antipsychotiques, diurétiques), ou être idiopathique.
L’hyperactivité détrusorienne peut être liée à une vessie neurologique, une infection urinaire, une sténose urétrale, un calcul distal de l’uretère, ou encore une tumeur de la vessie. Elle peut aussi être associée à une sensibilité vésicale augmentée, à une douleur pelvienne chronique, à l’utilisation d'agonistes bêta-adrénergiques, à la constipation, ou être idiopathique.
> Principales causesd’obstruction sous-vésicale
Si l’hypertrophie de la prostate (HBP/tumeurs) peut être en cause, d’autres anomalies peuvent être source d’obstruction sous-vésicale comme les rétrécissements du col de la vessie (sclérose du col de la vessie, maladie du col de la vessie) ou les rétrécissements de l’urètre (sténoses, calculs, valves).
Ainsi, une obstruction sous-vésicale ne présume pas forcément d’une origine prostatique.
L’HBP, fréquente à des degrés divers, n’entraîne des symptômes ou des complications que chez une minorité de patients. Le plus souvent, elle coexiste avec d’autres pathologies.
À noter également que la nycturie – cause fréquente de consultation – peut être liée à une augmentation de la fréquence des mictions nocturnes (pollakiurie nocturne), à une augmentation de la production nocturne d’urine (polyurie nocturne) ou à une augmentation de la diurèse totale (polyurie des 24 heures) et relever d’étiologies variées.
Un type de symptôme peut donc être dû à différentes causes, et inversement, une même étiologie peut donner divers symptômes.
L’ÉVALUATION INITIALE
Le bilan initial des SBAU de l’homme adulte repose d’abord sur une consultation de médecine générale. L’orientation vers un urologue ou un autre spécialiste des troubles urinaires (neuro-urologue, spécialiste en médecine physique et de réadaptation) pourra être nécessaire en seconde intention, en fonction des résultats de cette évaluation.
> Évaluation clinique
• Au niveau général
Certains facteurs de risque ou comorbidités liés à la survenue des troubles mictionnels doivent être recherchés, notamment : syndrome métabolique, facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, troubles du sommeil. Cela permet en outre de se faire une idée précise de l’état de santé du patient.
Faire également l’inventaire des traitements médicamenteux, dont certains peuvent être à l’origine de troubles urinaires.
• Sur le plan urologique :
Évaluation des symptômes urinaires pendant les phases de remplissage, mictionnelle et post-mictionnelle, mais aussi de leur impact sur la qualité de vie et sur la fonction sexuelle (trop souvent ignorée mais indispensable pour évaluer les répercussions des troubles mictionnels mais aussi, ultérieurement, connaître l’impact de la prise en charge sur cette dimension).
L’utilisation d’auto-questionnaires comme le score IPSS (International Prostate Symptom Score) peut être utile. Il peut être complété, voire substitué, par le VPSS (Visual Prostate Symptom Score), notamment en cas de difficulté de compréhension de la part du patient mais aussi de manière pratique parce qu’à la différence de l’IPSS il peut être rempli en quelques minutes.
• Un examen physique de l’abdomen, du plancher pelvien, des fosses lombaires, des organes génitaux externes sont préconisés ainsi qu’un toucher rectal (ce dernier ne dispense pas de la réalisation d’un examen d’imagerie pour évaluer le volume prostatique et dépister une pathologie maligne).
• Le calendrier mictionnel n’est plus systématique. Il est recommandé uniquement en cas de symptômes prédominants de la phase de remplissage, particulièrement en cas de nycturie. La production nocturne d’urine est considérée comme excessive lorsque le volume urinaire nocturne dépasse 20 % du volume urinaire des 24 heures chez un patient de moins de 65 ans et 30 % après 65 ans.
Pour être contributif, le calendrier mictionnel doit être réalisé pendant une période de 72 heures.
> Examens complémentaires
• Examens biologiques
Un test urinaire par bandelette réactive ou un ECBU est préconisé pour rechercher une hématurie, une leucocyturie ou une glycosurie.
L'évaluation de la fonction rénale n’est plus recommandée qu’en présence de facteurs de risque d'insuffisance rénale, en cas de rétention urinaire aiguë ou chronique, ou lorsqu'une anomalie morphologique du haut appareil urinaire est suspectée.
Dans la lignée des recommandations de la HAS sur le dépistage du cancer de la prostate, un dosage de PSA total doit être proposé, dans le cadre d’une décision partagée, à tout patient consultant pour des SBAU (symptômes de la phase mictionnelle mais pas uniquement), à fortiori en cas de suspicion clinique de cancer de la prostate.
• Imagerie
Une échographie de l’ensemble de l’appareil urinaire par voie abdominale (avec mesure du résidu post-mictionnel) est désormais préconisée de manière systématique lors du premier bilan, quels que soient les symptômes.
L’échographie permet de vérifier l’intégrité anatomique, l’absence d’autres pathologies mais également de mesurer le résidu post-mictionnel dans les conditions les plus physiologiques possibles.
L’échographie prostatique endorectale de la prostate, n’apporte rien à l’évaluation de première intention. Elle doit être réservée aux situations préthérapeutiques pour lesquelles une estimation précise du volume prostatique est nécessaire.
IRM prostatique et uro-TDM ne sont pas recommandées dans le cadre de l’évaluation initiale.
La mesure du résidu post-mictionnel est indispensable en cas de symptômes prédominants sur la phase mictionnelle, en privilégiant une mesure non invasive (échographie abdominale ou appareil de mesure automatisée). Un résidu post-mictionnel est considéré comme significatif lorsqu’il dépasse le tiers du volume vésical pré-mictionnel.
> À l’issue du bilan initial
En fonction des résultats du bilan initial, il peut être indiqué de surveiller le patient ou d’instaurer un traitement médical.
Un avis urologique pourra être nécessaire dans certains cas (voir tableau 1).
L'urologue pourra déterminer si des examens spécialisés, tels que la débitmétrie, l’urétrocystoscopie ou le bilan urodynamique, sont nécessaires.
Tableau 1: motifs de demande d’avis spécialisé

AVANT TOUT TRAITEMENT MÉDICAL
Avant la mise en œuvre d’un traitement médical, le bilan initial sera actualisé selon son ancienneté et complété.
> À l’interrogatoire
S’assurer de l’absence de contre-indications ou d’interactions médicamenteuses, en particulier chez la personne âgée.
(Ré)évaluer les symptômes urinaires (phases de remplissage, mictionnelle et post-mictionnelle), la qualité de vie urinaire ainsi que la fonction sexuelle.
> Pour les examens complémentaires
Ne pas réaliser de manière systématique des examens invasifs (cystoscopie, bilan urodynamique, échographie par voie endorectale).
Ne pas tenir compte de l’intensité des SBAU ou d’éléments morphologiques comme l’index de protrusion prostatique (IPP), l’épaisseur du détrusor ou le poids estimé de la vessie à l’échographie pour exclure la mise en route d’un traitement médical en première intention.
> Quand adresser le patient ?
La patient pourra être orienté vers un urologue :
- à l’issue du bilan préthérapeutique, en cas de complication type globe vésical, calculs de l’appareil urinaire, urétéro-hydronéphrose ou anomalies morphologiques de la prostate et de l’appareil urinaire (voir tableau 1) ;
- après mise en route d’un traitement médical en cas d’inefficacité ou de persistance d’un résidu post-mictionnel significatif.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt relatif au contenu de cet article


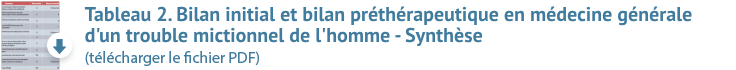
Cas clinique
La bisalbuminémie
Etude et Pratique
Prophylaxie post-TVP : AOD pleine dose ou demi-dose ?
Recommandations
La borréliose de Lyme
Mise au point
Palpitations : orientation diagnostique